| |
LE SEVRAGE
Comme
toute transition alimentaire, le sevrage est une opération
progressive qui permet de passer lentement du régime lacté
à une ration de croissance. C'est l'alimentation qui doit
s'adapter à l'évolution des capacités digestives
du chiot et non l'inverse.
Évolution
des capacités digestives du chiot
De nombreux
changements s'opèrent progressivement lors du développement
du chiot et ses capacités digestives évoluent.
Pour ne citer qu'un exemple, la quantité d'enzymes digestives
capables de digérer le lactose diminue progressivement
tandis que l'aptitude à digérer l'amidon cuit se
développe. Ces variations expliquent pourquoi certains
chiots ne tolèrent pas le lait de vache (trois fois plus
riche en lactose rapporté à la matière sèche
que le lait de chienne) et qu'il suffit parfois d'en limiter la
quantité pour stopper une diarrhée qui avait été
déclenchée par une saturation des capacités
enzymatiques.
Cette évolution est essentiellement déterminée
génétiquement et dépend peu des habitudes
alimentaires imposées aux chiots.
Conduite
du sevrage
Le début
du sevrage est naturellement imposé par le plafonnement
de la production lactée et pourrait être comparé
à un renoncement de la mère qui, ayant atteint son
niveau de production maximal, s'avoue incapable de satisfaire
plus longtemps les besoins croissants des chiots.
Chez les races miniatures, la lactation couvre la partie la plus
intense de la période de croissance des chiots et répond
ainsi à leurs exigences maximales.
En revanche, les chiots de moyenne et grande race seront privés
de lait maternel à un moment critique de leur croissance.
Si la période de gestation et de lactation s'avère
donc plus éprouvante chez les chiennes de petites races
que de races géantes, il n'en va pas de même pour
les chiots chez qui les risques sont inversés.
Quelle que soit la technique d'allaitement, le sevrage sera mené
comme une transition alimentaire progressive qui peut commencer
vers l'âge de 3 semaines pour se terminer vers 7 à
8 semaines, date à laquelle la mère commence
à se désolidariser de ses chiots en affirmant notamment
sa préséance alimentaire.
Il est préférable de ne pas séparer complètement
les chiots de leur mère avant cette date pour éviter
d'ajouter un stress pendant une période déjà
sensible à toute variation brutale du régime.
On pourra, par exemple isoler progressivement les chiots pendant
la journée pour les confier à leur mère pendant
la nuit.
Les exigences nutritionnelles des chiots au sevrage
sont qualitativement comparables à celles de leur
mère en fin de lactation (c'est, à,dire
pendant la période où elle reconstitue ses réserves),
ce qui facilite considérablement la tâche de l'éleveur.
En effet, si ce dernier ne dispose pas de bouillie de sevrage,
il peut mettre à la disposition des chiots quelques croquettes
maternelles (type croissance/lactation) mixées avec de
l'eau tiède ou du lait maternisé. Cet aliment sera
par la suite de moins en moins réhydraté pour être
finalement présenté tel quel en fin de sevrage.
Répétons ici que l'utilisation d'une alimentation
ménagère impose une correction minérale systématique
de la ration de base sous forme de complément du commerce,
de coquille d'oeuf pilée ou de poudre d'os, sous peine
d'entraver la minéralisation du squelette. Le réajustement
journalier que nécessite cette complémentation rend
cette pratique exceptionnelle de nos jours en élevage canin.
A l'inverse, l'adjonction d'un correcteur minéral à
une ration de base déjà équilibrée
(ration industrielle) risque, même chez les grandes races,
de conduire à des calcifications précoces et irréversibles
coin, promettant gravement la croissance et l'avenir des chiots.
L'alimentation de la portée avec une ration sèche
en libre service évite habituellement la concurrence alimentaire
entre les chiots et donc les diarrhées de surconsommation.
Elle peut être conseillée lorsqu'elle ne conduit
pas à une obésité.
Cette obésité qui interviendrait en pleine période
de multiplication des cellules graisseuses serait beaucoup plus
difficile à traiter qu'une surcharge graisseuse intervenant
à l'âge adulte.
Vermifugation
Seuls seront
abordés ici les cycles de reproduction et de transmission
des parasites les plus fréquemment rencontrés chez
les chiots en éle, vage canin, c'est-à-dire ascaris,
trichures, ankylostomes, taenia, giardia et coccidies.
- ASCARIDIOSE
Toxocara canis est le parasite le plus fréquemment
rencontré dans les collectivités canines. Il peut
provoquer chez les chiots des troubles respiratoires par migration
pulmonaire des larves et des troubles digestifs (ballonnement,
diarrhées, vomissements, voire perforation
intestinale), Ils nuisent également et parfois injustement
à la réputation de sérieux de l'élevage
et peuvent être à l'origine de graves contaminations
humaines (phénomène de larva migrans chez l'enfant)
.
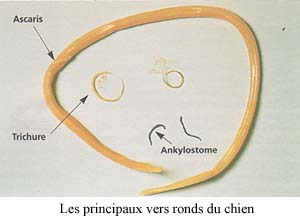 Les
chiens adultes hébergent généralement peu
d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent
un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur
où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée
quand les conditions sont défavorables à leur
éclosion. Les
chiens adultes hébergent généralement peu
d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent
un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur
où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée
quand les conditions sont défavorables à leur
éclosion.
Contrairement à l'espèce féline, les chiots
peuvent être infestés par les ascaris dès
la naissance par contamination transplacentaire.
Vers le 42e jour de gestation,
les larves d'ascaris qui « sommeillent » dans les
tissus de la mère se réveillent et migrent à
travers la barrière placentaire pour gagner le foie des
foetus où elles y demeurent jusqu'à la naissance.
Elles migrent ensuite vers l'appareil respiratoire des nouveau-nés
et peuvent provoquer à ce stade des épisodes de
toux vermineuse avec parfois expectoration de larves. Après
déglutition de ces larves, ces dernières se transforment
dans le tube digestif du chiot en vers adultes capables de pondre
des oeufs infestants dès la troisième semaine
de vie des chiots.
Les larves réactivées chez
la mère peuvent également gagner les mamelles
et contaminer les chiots au cours d'une tétée.
Ces modes de transmission qui ne représentent
pas les seules voies de contamination (ingestion directe d'oeufs
ingestion d'hôtes intermédiaires comme les rongeurs)
et la persistance des larves enkystées résistantes
à la majorité des vermifuges dans les tissus pendant
toute la vie du chien expliquent la grande incidence des ascaris
dans les collectivités canines et les difficultés
de la prévention et du traitement des ascaridioses.
En milieu infesté, il est préconisé
de déparasiter les lices quelques jours avant la saillie
à l'aide d'un vermifuge actif sur les vers ronds adultes.
Vers le 42e jour, période de réactivation des
larves enkystées, il faut privilégier les vermifuges
qui s'administrent sur plusieurs jours consécutifs (Fenbendazole,
Flubendazole, etc.) qui semblent plus actifs
sur les
larves en migration (ex: Panacur chien NDV). Il importe de renouveler
ce traitement fréquemment jusqu'au 15e jour de lactation
pour agir sur les larves dès leur réveil et avant
l'accomplisse, ment de leur migration. Il ne faut en effet pas
oublier que la mère peut être recontaminée
par ses propres chiots au cours de la toilette périnéale.
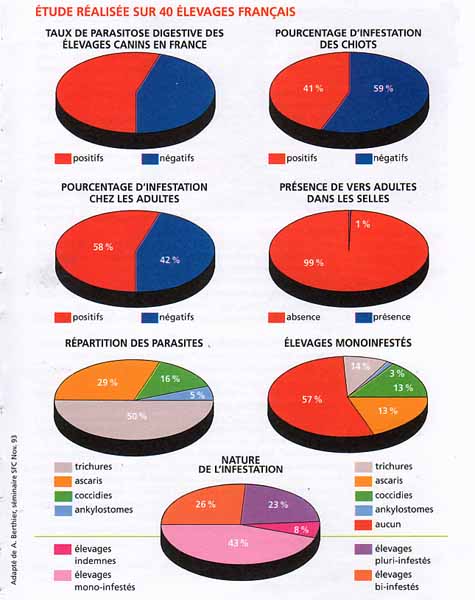 Lors
d'infestation massive, la portée sera vermifugée
à partir de la 3e semaine et toutes les deux
semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis
tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec
un vermifuge plus classique. Lors
d'infestation massive, la portée sera vermifugée
à partir de la 3e semaine et toutes les deux
semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis
tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec
un vermifuge plus classique.
Parallèlement, la prévention des intercontaminations
passera par le brûlage des excréments
et le traitement des surfaces susceptibles d'héberger
des larves ou des oeufs (lance-flamme horticole, vapeur d'eau
surchauffée, sulfate ferreux, superphosphate de chaux
... ) sans oublier le nettoyage soigneux du matériel
et du personnel susceptibles de transporter des souillures.
De ces constatations biologiques, il importe pour l'éleveur,
de retenir les points suivants :
- La vermifugation des
lices avant la saillie ne permet de la débar, tasser
que des vers adultes présents dans le tube digestif Aucun
vermifuge n'est actuellement actif sur les larves en sommeil.
- Les larves en sommeil se réactivent continuellement
à partir du 42e jour de gestation et peuvent contaminer
les chiots au cours de la fin de gestation et pendant la lactation.
- Les chiots peuvent se contaminer entre eux et réinfester
leur mère .
- Rien ne sert de vermifuger les chiots avant la troisième
semaine (puisqu'ils ne sont pas encore contagieux) à
moins d'utiliser des pro~ duits larvicides souvent toxiques
à cet âge.
- ANKYLOSTOMOSES L'ankylostomose
se traduit cliniquement par des anémies et des entérites
graves, voire mortelles lorsqu'elles affectent les chiots.
Comme
pour l'ascaridiose, il existe une possibilité de
réactivation des larves enkystées au
cours de la gestation et de la lactation.
Cependant,
les ankylostomes se rencontrent moins fréquemment en
France dans les élevages canins car il est plus facile
d'interrompre leurs cycles de développement en évitant
les surfaces herbeuses boueuses ou sablonneuses propices
à l'éclosion des oeufs et au déveloepement
des larves. Une bonne hygiène externe
limite également les possibilités de pénétration
transcutanée des larves.
Enfin,
la plupart des vermifuges actifs sur les ascaris protègent
également des ankylostomes.
- TRICHUROSE
Les trichures sont très répandus chez les chiens
vivant en meute ou en chenil.
Leurs oeufs
sont encore plus résistants dans le milieu extérieur
que les oeufs d'ascaris puisqu'ils
peuvent y persister plus de cinq ans.
 Cependant,
la période prépatente (« incubation »)
dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient
pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire
avant leur cession. Cependant,
la période prépatente (« incubation »)
dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient
pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire
avant leur cession.
Des symptômes de colite chronique affectant
plusieurs chiens adultesde l'élevage doivent faire suspecter
une trichurose.
La plupart des ascaricides actuellement sur le marché
sont également actifs contre les trichures (sauf le nitroscanate).
- COCCIDIOSE
ET GIARDIOSE
Les coccidies et les giardia sont des parasites unicellulaires
rarement pathogènes isolément mais qui peuvent
compliquer parfois les diarrhées néonatales d'origine
virale, bactérienne ou parasitaire.
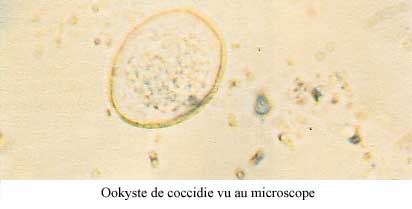 Les
principaux obstacles à leur éradication en élevage
canin sont,d'une part, leur excrétion fécale
intermittente rendant leur isolement aléatoire
au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,
l'inefficacité des vermifuges classiquement
utilisés dans les collectivités canines. Les
principaux obstacles à leur éradication en élevage
canin sont,d'une part, leur excrétion fécale
intermittente rendant leur isolement aléatoire
au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,
l'inefficacité des vermifuges classiquement
utilisés dans les collectivités canines.
Une enzootie de diarrhée affectant essentiellement
les chiots entre 4 et 6 semaines d'âge et semblant
épargner les adultes doit faire recher- de coccidie vu
cher, entre autres, la présence de coccidies
(Isospora canis). au microscope. Des malabsorptions
ou des diarrhées chroniques ne rétrocédant
pas aux vermifuges et aux antibiotiques classiques feront suspecter
une giardiose, souvent sous-estimée
en France à cause des difficultés de diagnostic.
- TAENIASIS
Le mode d'alimentation industrielle généralement
adopté par la majorité des éleveurs limite
de nos jours les possibilités de contamination par un
taenia des chiens suite à une ingestion de carcasses
ou d'abats infestés.
Seul Dipylidium caninum se rencontre encore fréquemment
chez le chien. Ce ver plat se transmet le plus souvent par ingestion
de puces (hôtes intermédiaires) ou d'excréments
hébergeant des segments de taenia. Le traitement vermifuge
est facile (Praziquantel ou Imidazolés) mais il doit
s'accompagner d'une désinsectisation soigneuse des chiens
et de leur environnement qui s'avère beaucoup plus contraignante.
 L'infestation,
souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons
anales (signe du traîneau) ou être révélée
par la découverte fortuite de petits éléments
en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les
marges de l'anus. L'infestation,
souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons
anales (signe du traîneau) ou être révélée
par la découverte fortuite de petits éléments
en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les
marges de l'anus.
Signalons à ce sujet qu'il n'existe pas d'oxyures
dans l'espèce canine.
De ce bref aperçu du parasitisme interne en élevage
canin, retenons les points clefs suivants
- Il existe principalement trois
formes de parasites digestifs chez le chien : vers
ronds (ascaris, trichures et ankylostomes), ver plat (taenia)
et protozoaires (coccidies, giardia).
- On ne peut demander à un vermifuge d'être efficace
contre toutes ces formes parasitaires. Certains antiparasitaires
auront un spectre large, d'autres un spectre plus ciblé
sur un parasite identifié. Etant donné le coût
très modique d'une analyse coproscopique
collective en élevage, il est fortement recommandé
de prélever deux fois par an un échantillon de
selles provenant d'une dizaine de chiens et de les expédier
pour un contrôle à MMES ou dans tout établissement
vétérinaire. L'étude des cycles et des
symptômes permettra de prélever les
échantillons en fonction des risques liés au stade
et au mode de vie de chaque chien.
Cette méthode s'avère beaucoup plus efficace
et économique que des vermifugations systématiques
en aveugle ! Quelques élevages ont même réussi
à s'affranchir de tout usage de vermifuge au prix d'une
identification des parasites suivie d'une rupture de ses cycles
de contamination.
- Même si de nombreux éleveurs déplorent
l'absence de vermifuges économiquement adaptés
à leur exploitation, le recours à des vermifuges
non autorisés pour l'espèce canine ne peut se
faire que sous l'entière responsabilité du prescripteur.
Les vermifuges adaptés aux espèces de rente, même
s'ils renferment souvent des principes actifs comparables, n'ont
pas le même excipient et se révèlent parfois
inactifs, voire toxiques pour le chien.
A
titre d'exemple, certaines races comme le Colley, le Bobtail
ou le Boxer expriment une sensibilité
particulière à l'ivermectine, vermifuge injectable
qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM)
pour l'espèce canine.
- La prévention (hygiène, connaissance
minimale de la biologie des parasites, quarantaine, identification
des facteurs de risque ... ) reste encore une fois, dans ce
domaine, beaucoup plus rentable et gratifiante que le traitement.
- Penser à incinérer les selles
émises après une vermifugation. Cette simple précaution
évitera bien des recontaminations.
La
date de sortie du chiot hors de l'élevage ne dépend
pas uniquement de sa maturation physique (achèvement du
sevrage, capacités d'autonomie, état sanitaire ...
) mais également de son développement comportemental
(aptitude à s'insérer dans son nouveau milieu).
|
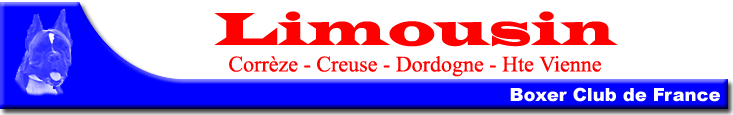


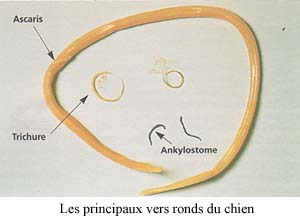 Les
chiens adultes hébergent généralement peu
d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent
un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur
où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée
quand les conditions sont défavorables à leur
éclosion.
Les
chiens adultes hébergent généralement peu
d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent
un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur
où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée
quand les conditions sont défavorables à leur
éclosion.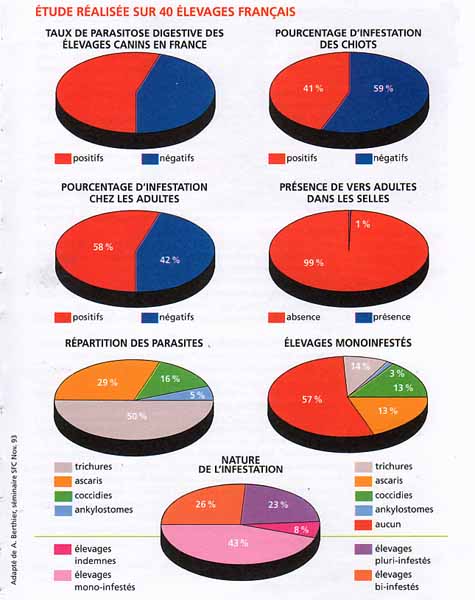 Lors
d'infestation massive, la portée sera vermifugée
à partir de la 3e semaine et toutes les deux
semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis
tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec
un vermifuge plus classique.
Lors
d'infestation massive, la portée sera vermifugée
à partir de la 3e semaine et toutes les deux
semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis
tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec
un vermifuge plus classique. Cependant,
la période prépatente (« incubation »)
dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient
pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire
avant leur cession.
Cependant,
la période prépatente (« incubation »)
dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient
pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire
avant leur cession. 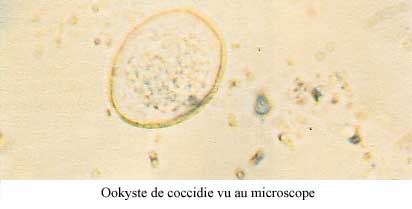 Les
principaux obstacles à leur éradication en élevage
canin sont,d'une part, leur excrétion fécale
intermittente rendant leur isolement aléatoire
au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,
l'inefficacité des vermifuges classiquement
utilisés dans les collectivités canines.
Les
principaux obstacles à leur éradication en élevage
canin sont,d'une part, leur excrétion fécale
intermittente rendant leur isolement aléatoire
au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,
l'inefficacité des vermifuges classiquement
utilisés dans les collectivités canines. L'infestation,
souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons
anales (signe du traîneau) ou être révélée
par la découverte fortuite de petits éléments
en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les
marges de l'anus.
L'infestation,
souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons
anales (signe du traîneau) ou être révélée
par la découverte fortuite de petits éléments
en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les
marges de l'anus.